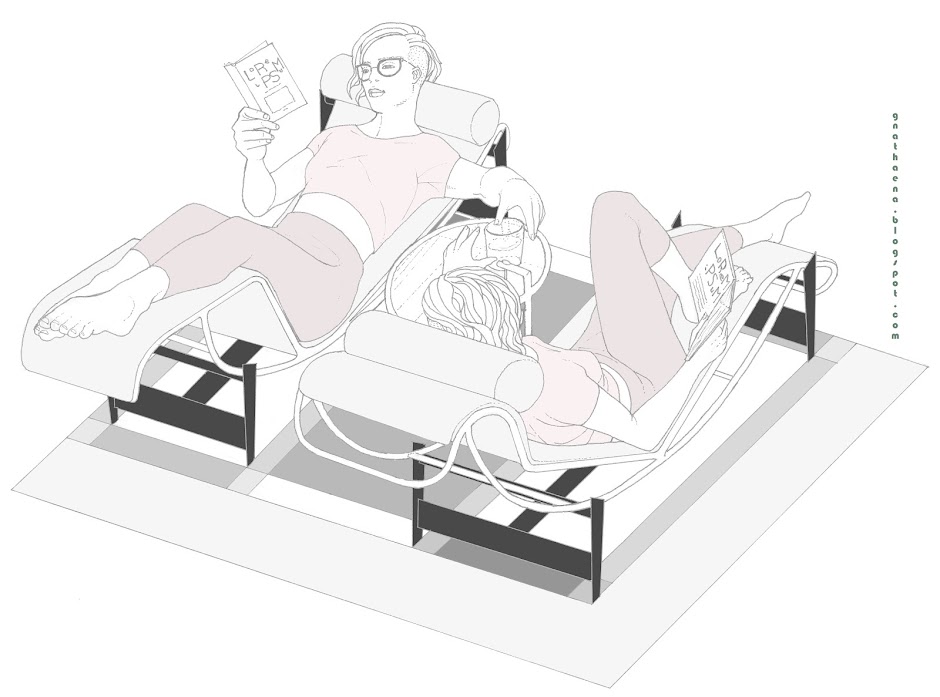Sources :
Hermann
Diels 1903, Walther Kranz 1951, Fragmente
der Vorsokratiker,
traduction
sous la direction de Jean-Paul Dumont, Les
Présocratiques,
Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2000
Articles
cités :
Sexe,
genre et philosophie #2 gnathaena.blogspot.com 2022 :
Hésiode
Sexe,
genre et philosophie #3 gnathaena.blogspot.com 2023 :
Thalès, Anaximandre, Anaximène
Sexe,
genre et philosophie #4 gnathaena.blogspot.com 2023 :
Pythagore
Sexe,
genre et philosophie #5 gnathaena.blogspot.com 2023 :
Héraclite
Sexe,
genre et philosophie #6 gnathaena.blogspot.com 2023 :
#1 Xénophane
(1)
Un
couple pythagoricien
Parménide
est issu d’une famille de riches notables d’Élée. La tradition
hésite à en faire un élève de Xénophane ou un membre de la secte
pythagoricienne. Il semble qu’il ait bien
été initié au pythagorisme et qu’il ait opté pour la voie
« politique » par opposition à la voie « religieuse »,
dans un contexte où l’unité politique de l’Italie du Sud n’est
plus au programme et où chaque pythagoricien.ne tâche d’œuvrer
dans le cadre limité de sa propre cité. Il semble aussi qu’il ait
rompu avec la secte, non pas en la trahissant, mais en publiant sa
propre philosophie. Celle-ci, réduite à un unique poème qu’il a
remanié tout au long de sa vie en multipliant ses éditions, met en
avant deux philosophes non pythagoriciens : Xénophane et
Héraclite, le premier pour s’en inspirer, le second pour s’en
écarter.
Zénon,
fils d’un philosophe d’Élée, semble avoir joui d’une fortune
plutôt médiocre. Il a sans doute fréquenté Parménide assez tôt,
celui-ci ayant possiblement financé son initiation à la secte
pythagoricienne, dont il emprunte à son tour la voie « politique ».
Si Xénophane n’est pour Parménide qu’une source d’inspiration,
des liens très étroits unissent Parménide et Zénon, dont l’œuvre
consiste essentiellement en une défense, célèbre par l’emploi
des fameux paradoxes qui portent son nom, du poème parménidien.
Parménide a été le maître de Zénon en même temps qu’il a
financé sa formation philosophique, semblable à
celle qu’il avait
reçue. Il en a fait son héritier en l’adoptant, et Platon
soutient qu’il a été son mignon.
La
tradition a fait du couple de Parménide et de Zénon le modèle de
l’unité de base d’une société vertueuse masculine dégagée du
féminin. Leur amitié dissymétrique est en effet fondée sur une
transmission intergénérationnelle masculine, émancipée de la
reproduction sexuée par la voie de l’adoption, et cimentée par
une intimité homosexuelle, double moyen de se soustraire à
l’influence féminine. Parménide a joué un rôle politique
important en donnant à Élée un corpus de lois que les citoyen.ne.s
s’engageaient annuellement à respecter. Connaissant, dans la
seconde moitié du – Ve siècle, la crise politique frappant
l’ensemble des cités grecques oligarchiques, Élée a eu
ses tyrans, insoucieux par principe de suivre les lois
parménidiennes. Zénon aurait alors comploté contre Néarque ou
Diomédon ou encore Démylos (c’est dire nos maigres connaissances
de l’histoire politique de cette petite cité !), y aurait
sacrifié l’instrument de sa renommée philosophique, sa langue,
pour ne pas trahir les siens, et y aurait perdu la vie.
Tous
ces indices nous font soupçonner qu’ici commence l’histoire du
masculinisme philosophique, mais aussi que cette histoire est
celle d’un masculinisme renouvelé, très différent du
masculinisme traditionnel.
(2)
Le poème de Parménide
Du
poème de Parménide, intitulé De la nature (Péri
physèôn), écrit à la manière de Xénophane,
correctement métré mais globalement impropre au chant (on le lisait
collectivement à voix haute, éventuellement on l’apprenait par
cœur et on le restituait aux amis, dans les sociétés masculines
lettrées), il ne nous reste qu’un modèle réduit dont on échoue
à repérer les évolutions dues aux rééditions du vivant de
l’auteur. Du moins peut-on en suivre la ligne générale.
(2-1)
Une ouverture au féminin
L’introduction
du poème, quoiqu’elle prenne la forme volontairement parodique du
vers épique, poursuit un objectif particulièrement ambitieux :
interroger et classer les discours sur
la
nature des choses.
Parménide
se met en scène dans un char conduit par des cavales sur le chemin
qui mène au séjour de la « Divinité », à savoir la
Sagesse, qui oriente
le philosophe dans sa quête du juste discours. C’est le matin, les
portes du palais de Nuit
viennent de s’ouvrir, les filles d’Hélios se sont élancées
vers le zénith, où se
trouve le temple de la Sagesse, au
milieu du jour, où la lumière règne sans partage, où l’ombre se
trouve réduite à son minimum. On retrouve là un thème cher à
Thalès (la lumière règne sur le monde tel qu’il est
actuellement, le règne de la Nuit est toujours au passé). Ayant,
avec l’aide des jeunes filles, atteint et franchi les portes du
temple, voilà notre philosophe devant sa divine matrone.
« […]
Apprends donc toutes choses, / et aussi bien le cœur
exempt de tremblement / propre à la vérité bellement
circulaire, / que les opinions des mortels dans
lesquelles / il n’est rien qui soit vrai et digne de
crédit ; / mais cependant aussi, j’aurai soin
de t’apprendre / comment il conviendrait que soient,
quant à leur être, / en toute vraisemblance, lesdites
opinions, / qui toutes vont passant toujours. »
(fr. I)
Sur
la nature des choses, il y a trois types de discours. L’un est tenu
« le cœur exempt de tremblement », ce qui est le propre
de la vérité. Le second est faux et éveille immédiatement la
méfiance. Le dernier correspond à la limite de l’acceptable pour
un discours sur la nature. Il est faux, mais le
réfuter
est difficile et réclame du temps, et pourtant il arrive
toujours un moment où il est remplacé par un discours plus efficace
quoique tout aussi faux. Il se distingue du second discours en ce que
celui-ci se réfute
au moment même où il s’énonce, tandis que les contradictions de
celui-là sont plus difficiles à résoudre.
En
présentant ces trois types de discours sur la nature, la Sagesse a
élevé la pensée à ses sommets : ceux de la métascience, de
la « logologie », du discours sur les discours.
L’héritage pythagoricien de Parménide s’exprime ici de façon
éclatante. L’ascension s’est faite avec les seuls secours et
concours de jeunes déesses attirées par la science et d’une
divine matrone
en métascience. Parménide raille-t-il ici les sages « à
l’ancienne », qui invoquent les Muses et se laissent guider
par elles ? Ou bien admet-il au contraire, avec ses
prédécesseurs (de Thalès à Héraclite), le caractère féminin de
la sagesse ? Ces deux attitudes ne me semblent pas
incompatibles, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de
la « révolution philosophique » engagée par Xénophane,
qui dévalorise les acquis de la sagesse pré-philosophique (dont les
grandes figures sont Homère, Hésiode et Orphée) tout en se les
appropriant (cf. mon article précédent).
(2-2)
L’être et le non-être
Avant
d’aborder les trois types de discours sur la nature, il est
nécessaire d’évoquer en préambule le problème pythagoricien de
la dyade et de son rapport à la monade.
Le
monde dans son ensemble est unifié tout en étant différencié. La
monade est ce qui confère
son unité à l’ensemble
du monde, et la dyade ce qui le différencie. La monade régit la
dyade : non seulement les différences qui existent dans le
monde ne font
pas obstacle à
son unité, mais elles contribuent positivement à cette unité dans
la mesure où elles forment les briques d’un ordre cosmique
universel. L’école
pythagoricienne montre que pour
qu’un monde soit différencié sans
perdre son unité d’ensemble,
il est nécessaire qu’il soit formé
à partir d’au moins deux
couples de qualités opposées (chaud / froid, sec / humide). L’être
peut alors prendre quatre formes liées les unes aux autres tout en
s’opposant deux à deux (feu, air, eau, terre). Ces quatre formes
sont éternelles, équilibrées entre elles, et susceptibles, par
leurs liaisons, de constituer des « molécules »
complexes de particules élémentaires, plus ou moins stables. Ce
sont les êtres formés de ces « molécules » qui sont
mortels. Le monde pris à son niveau élémentaire est toujours déjà
achevé : la dyade des oppositions élémentaires n’oppose
pas de l’achevé à de l’inachevé, mais de l’incompatible
(chaud, sec)
à de l’incompatible (froid,
humide). Cette
incompatibilité est le facteur de différenciation élémentaire du
monde. Elle est régie par la monade qui
fait que les qualités
opposées, quoique incompatibles entre elles, sont sources d’un
ordre cosmique élémentaire où feu, air, eau, terre ont chacun.e
leur place.
La
monade est par ailleurs ce
qui confère son unité et
sa complétude à chaque
chose mortelle. La
dyade représente alors
l’opposition des choses
parvenues à leur point d’achèvement, aux
choses non achevées, soit
parce qu’elles ne le sont pas encore, soit parce qu’elles ne le
sont plus. La dyade oppose ainsi, pour une même chose mortelle,
sa plus grande proximité et sa plus grande distance à la monade.
Être au plus près
de la monade se traduit par le fait d’être véritablement
doté de toutes les qualités
attribuables à son espèce, ce
qui a pour conséquence de
pouvoir être évoqué dans un discours vrai référant
auxdites qualités (« X est un être
humain ; or
l’être humain voit ;
donc X
voit »). Être au plus loin de la monade se traduit au
contraire par le fait de ne pas être véritablement, de ne
pas posséder toutes les qualités de son espèce et, plus grave, de
ne pouvoir être évoqué sans risque pour
la vérité dans un discours référant
à ces qualités (si X est aveugle, bien que
X soit un être
humain, X
ne voit pas). Ces qualités
propres à chaque espèce sont potentiellement en nombre infini, du
fait de la capacité indéfinie des molécules de particules
élémentaires à se combiner entre elles, chaque combinaison
nouvelle donnant lieu à de nouvelles oppositions qualitatives. Pour
autant, cette illimitation des qualités non
élémentaires se
trouve soumise à la dualité
première de l’être achevé et de l’être inachevé, ce qui
n’est possible que parce que la monade transcende la dyade des
qualités transitoires.
Le système pythagoricien
suppose, pour les êtres
mortels, la soumission d’un
illimité transcendé (la
dyade) à
un limitant transcendant (la
monade).
Parménide
radicalise en quelque sorte ce système.
Il
commence par abolir la distinction entre les oppositions
qualitatives élémentaires (incompatibles entre elles) et les
oppositions qualitatives propres aux êtres mortels (qui se ramènent
à celle de l’être achevé et de l’être inachevé). Il réduit
ensuite toutes les oppositions à celle de l’être et du non-être,
ce qui a deux conséquences.
Si
être achevé, c’est simplement être et si être inachevé, c’est
ne pas être, alors
la
naissance, la croissance, le vieillissement et la mort, qui mettent
en relation les deux opposés, deviennent problématiques. Car quel
point commun peut-il y avoir entre le non-être et l’être,
permettant
de dire que le « même »
quelque chose passe du non-être à l’être et réciproquement ?
Soit en effet ce point commun
« est » et il
est incompatible avec le
non-être, soit il
« n’est pas », auquel cas il
est incompatible avec l’être.
Le
monde ne connaît plus aucune différenciation interne. L’être
et le non-être sont en effet
séparés par une barrière infranchissable. Une rencontre entre eux
n’a aucun sens. Dans un
monde régi par l’opposition de l’être et du non-être, l’être
prend toute la place et le non-être s’éclipse complètement.
Seul
l’être, parce que radicalement séparé du non-être, est réel.
De lui seul on peut parler de façon véridique, et du non-être on
ne peut absolument rien dire. Quant au monde perçu, intermédiaire
entre l’être et le non-être, tout ce que l’on pourra en dire
sera immanquablement réfuté : éphémère et changeant, il
n’est qu’illusion. Parménide soumet l’illusion cosmique à la
transcendance de l’être. En exacerbant ainsi la position
pythagoricienne, il ne fait pas autre chose que renouer avec
Anaximandre, pour qui le monde est le rêve d’une mère
transcendante. Mais l’être parménidien est-il vraiment
l’équivalent de l’Illimité anaximandrien ?
(2-3)
Être et pensée
« Car
même chose sont et le penser et l’être. » (fr. III)
« On
chercherait en vain le penser sans son être / en qui
il est un être à l’état proféré. » (fr. VIII)
« Penser,
c’est être », « on ne pense qu’en référence à un
être », « l’être s’exprime dans la pensée » :
telles sont les interprétations les plus courantes de ces deux
fragments. En fait, ce que veut dire Parménide :
c’est
qu’on ne peut pas penser sans penser en référence à quelque
chose, à un
être dont la pensée est l’expression et qui la précède ;
un fragment souligne la
valeur simplement expressive de la pensée :
« Car
la chose consciente et la chair ou substance / dont nos membres sont
faits, sont une même chose / en chacun comme en tout :
l’en-plus est la pensée. » (fr. XVI)
mais
c’est aussi que
la pensée dispose comme d’un être propre quand elle réfléchit
sur elle-même ; elle
est alors tentée de rompre
avec son origine, de penser
au-delà de ce d’où elle
provient, au-delà de l’être
qu’elle exprime, de remonter au point où l’être se sépare du
non-être, assistant en
quelque sorte à
la naissance de l’être : les
théogonies naissent de
cette tentation de la pensée réflexive ;
or,
là est
le point important, penser au-delà de l’être revient
à penser au-delà de la
pensée : c’est impossible ; l’être unifie
et remplit
la pensée et la pensée ne
peut pas penser au-delà de ce qui lui confère son
unité et sa
plénitude ; l’acte
créateur qui, chez Hésiode,
donne naissance à Chaos, Gaïa, Tartaros et Éros, est impensable,
or
c’est cet impensable que voudrait conquérir la pensée qui se
replie sur elle-même. Elle
ne le peut qu’en faisant
erreur.
Pour
Parménide, la pensée, en tant qu’expression naturelle de l’être,
s’est écartée de la voie de la vérité pour s’engouffrer dans
celle de la tromperie et
de l’erreur. L’âge d’or s’est clos et l’âge de fer
commence. L’apport de Parménide à ce vieux motif philosophique
est de lier la distinction des âges à celle des voies discursives,
et de qualifier ce lien sur un plan affectif. La pensée connaît son
âge d’or dans la contemplation sereine de la vérité, elle a son
âge de fer dans l’intranquillité de la tromperie. Entre les
deux : l’âge de bronze de la pensée
muette, de la pensée
incapable de penser.
(2-4)
Première voie
« Viens,
je vais t’indiquer […] quelles sont les seules / et
concevables voies s’offrant à la recherche. / La première, à
savoir qu’il est et qu’il ne peut / non-être,
c’est la voie de la persuasion, / chemin digne de foi
qui suit la vérité ; / [...] » (fr. II)
« Mais
il ne reste plus à présent qu’une voie / dont on
puisse parler : c’est celle du « il est ». / Sur
cette voie, il est de fort nombreux repères, / indiquant
qu’échappant à la génération, il est en même temps exempt de
destruction : / car il est juste formé tout d’une
pièce, / exempt de tremblement et dépourvu de fin. /
Et jamais il ne fut, et jamais il ne sera, / puisque au
présent il est, tout entier à la fois, / Un et un continu. Car
comment pourrait-on / origine quelconque assigner au
« il est » ? / Comment s’accroîtrait-il et d’où
s’accroîtrait-il ? / […]
Aussi faut-il admettre / qu’il est absolument, ou
qu’il n’est pas du tout. / […]
Aussi Dikè [déesse du Droit]
lui a, l’enserrant dans ses liens, / de naître ou de
périr, ôté toute licence : / en fait, elle le
tient. L’arrêt en la matière / stipule simplement :
il est ou il n’est pas. / […] Et il n’est pas non plus /
divisible en effet, puisqu’il est en entier, / sans
avoir çà ou là quelque chose en plus / qui pourrait
s’opposer à sa cohésion, / ou quelque chose en
moins. Il est tout rempli d’être. / Aussi est-il tout continu. En
effet, l’être / embrasse au plus près l’être. […] Il
est en lui-même immobile en son lieu ; / car la
Nécessité [Anankè,
autre déesse] puissante le tient / dans
les liens l’enchaînant à sa propre limite. […] Mais
puisqu’existe
aussi une limite extrême, / il est de toutes
parts borné et achevé, / et gonflé à
l’instar d’une balle bien ronde, / du centre vers
les bords en parfait équilibre. / […] en toutes
directions, il s’égale à lui-même / et de même
façon, il touche à ses limites. » (fr. VIII)
La
première voie est celle du « il est » (« ei »),
verbe être à la troisième personne. Elle conduit de l’être
affirmé véridiquement au sujet de ce qui est, aux qualités que
l’on peut véritablement attribuer à ce qui est. On passe ainsi du
« est » au « il ». La meilleure traduction du
« ei » serait sans doute celle que Freud aurait pu
donner : « ça est ». L’être s’impose de
lui-même comme acte d’être dont l’entêtement rend manifeste un
« ça », origine et fin indissociables de l’acte
d’être : un être en acte d’être. Voilà le
chemin de la « vérité bellement circulaire ».
Ou
bien rien n’est ou bien l’être est tout : telle est
l’alternative assignée par Dikè à l’être et au non-être.
Cette totalité de l’être s’entend en deux sens : temporel
et spatial. C’est la première fois que ces deux dimensions sont
aussi bien distinguées : l’être est en effet illimité dans
le temps et limité dans l’espace, telle est la formule de sa
totalité. On remarque que si l’illimitation temporelle repose sur
l’argument logique selon lequel rien ne se crée ni ne se détruit,
parce que l’être et le non-être n’ont absolument rien de
commun, que l’être ne peut surgir du non-être et s’y dissoudre,
la limitation spatiale s’appuie, quant à elle, sur l’intervention
ex machina d’Anankè. On
comprend que Parménide souhaite faire de l’être la monade
pythagoricienne transcendante,
mais « incarnée »,
rendue
immanente à elle-même.
La monade étant limitante du
fait de sa transcendance,
appliquée à elle-même, elle est limitée du
fait de son immanence.
Anankè, la nécessité,
représente la contrainte qui s’impose à la monade, lorsqu’elle
devient la vérité du
monde et non plus simplement son facteur de cohésion.
Les
qualités que doit posséder l’être pour être sont les
suivantes :
Présent
à soi : « ei » est en effet au présent, la
tension liée à l’acte d’être n’est jamais au passé ou au
futur, on ne peut jamais parler d’avant son commencement ni
d’après son terme, on ne
sort
pas de l’être.
Un
et
indivisible : l’être
en acte d’être, s’il était multiple, serait coupé de
lui-même, mais il n’y a rien d’autre que lui pour s’interposer
entre lui et lui. Et s’il
était divisible, il pourrait être séparé de lui-même, mais il
n’y a rien d’autre que lui-même pour opérer cette séparation.
Or, et c’est là
l’originalité de Parménide, l’être n’est en aucune manière
opposé à lui-même, il n’y a pas de non-être relatif,
c’est-à-dire un être qui serait non-être pour un autre être ou
pour lui-même. C’est
toute la tradition d’Anaximandre à Héraclite qui est évacuée :
le monde dans
sa vérité n’est
pas en conflit avec lui-même, ni de manière temporaire ni de
manière durable. Il
est la monade
appliquée à elle-même, facteur d’unification unifié par soi,
il ne saurait entamer en
lui-même une division ni se maintenir dans la multiplicité.
Immobile
et borné :
étant unifié par sa propre
vertu,
il
se tient
dans ses
limites, bornes qui ne signalent
aucune frontière mais la limite absolue de l’être, limite sans
au-delà, marquant
uniquement un en deçà.
Achevé
tel une
balle bien
ronde : débarrassé du
non-être, l’être vrai du monde n’est plus dyadique mais
monadique : seule la série des qualifications de l’être
achevé est
vraie, il n’y a pas d’être inachevé, naissant ou périssant,
l’acte d’être ne rencontre aucun obstacle extérieur
et il ne
se fait pas obstacle à lui-même, ses
bornes ne sont pas des obstacles derrière
lesquels il trouverait à
être plus ou mieux.
L’acte
d’être en tant qu’unification de soi est un acte mesuré. Le
rapport du centre à la périphérie était considéré par
Anaximandre comme une opposition, la première de toutes ; pour
Parménide, il définit une
figure géométrique, la « boule », par le
biais de son rayon, qui en
est la
mesure. Cela a fait beaucoup
rire les contemporains du philosophe.
Il
ne faisait pourtant que suivre les recommandations de Xénophane en
matière de figuration divine. L’être parménidien est en
l’occurrence l’équivalent du quatrième principe xénophanien :
Hélios, dont la figurabilité est « à la limite »,
parce qu’il est ce qui simultanément rend possible la vision et
aveugle quand on tourne ses yeux vers lui.
En
tant que monade immanente à soi, l’être vrai se transcende
lui-même : d’un côté, il est acte pur transcendant, de
l’autre il est une boule transcendée par l’acte qui la
constitue. Sa parenté avec l’Illimité d’Anaximandre est encore
une fois évidente, à ces deux différences près :
l’Illimité
est fécond en mondes temporaires, ce qui n’est absolument pas le
cas de l’être vrai, parfaitement stérile ;
l’Illimité
l’est dans le temps et dans l’espace, alors que l’être vrai
est limité dans l’espace et illimité dans le temps : sa
limitation, le lien d’Anankè (« si tu dois être, alors tu
as à te fixer une mesure immuable »), l’Illimité ne peut
la connaître, car non seulement il est tout, mais toujours au-delà
de tout.
Par
ces deux différences, il est possible de dire que l’être vrai
de Parménide se dit au masculin, un masculin qui ne parvient à
s’exprimer que par son opposition au féminin et plus exactement à
l’une des figures du féminin, à Gaïa, mère de la race d’argent,
à la mère toute-puissante qui enveloppe tout et n’a aucune
limite, source de la démesure de ses enfants. Par contraste, l’être
vrai, boule sous tension, est Dieu solitaire, stérile, au présent,
tout concentré sur soi, doté d’une mesure absolue, dégagé
de toute relation de maternité. Or, d’une part, il ne tient
pas sa tension de lui-même mais d’Anankè, et, d’autre part,
plus profondément, l’alternative entre être seul toujours et ne
rien être jamais, commandée
par Dikè, reste suspendue à la décision d’un tiers au-delà de
l’être et du non-être, au-delà du temps et de l’espace. Comme
nous l’avons vu, en philosophie, depuis Thalès, accorder du crédit
au masculin se compense par le fait de revaloriser le féminin pour
maintenir la primauté de celui-ci sur celui-là (a rebours du
jugement social en la matière). C’est bien ce qui semble se passer
ici : le tiers qui a fait le choix de l’être contre le
non-être est le féminin absolu, dont les hypostases sont Sophia,
Dikè, Anankè et les filles d’Hélios,
selon le plan où l’on se situe.
(2-5)
Seconde voie
« […]
la seconde, à savoir qu’il n’est pas, et qu’il
est / nécessaire au surplus qu’existe le non-être,
/ c’est là, je te l’assure, un sentier incertain /
et même inexplorable : en effet le non-être / (lui
qui ne mène à rien) demeure inconnaissable / et reste
inexprimable. » (fr. II)
« On
ne pourra jamais par la force prouver / que le non-être
a l’être. Écarte ta pensée / de cette fausse voie
qui s’ouvre à ta recherche. » (fr. VII)
La
première voie, celle du « il est », pouvait s’énoncer
plus complètement en « il est et il est nécessaire que le
non-être ne soit pas ». Elle respectait l’alternative « ou
bien il est, ou bien rien n’est ». Sa négation logique est :
« il n’est pas ou il n’est pas nécessaire que le non-être
ne soit pas ». Le « ou » étant ici inclusif, cela
recouvre trois cas possibles :
« il
n’est pas et il est nécessaire que le non-être ne soit pas »
est la formule correspondant
à « … ou bien rien n’est » : elle
complète la formule de la première voie ;
elle aurait pu être vraie si la divinité suprême avait choisi
contre l’être ;
« il
n’est pas et il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit
pas » s’oppose terme à terme à la formule de la première
voie. En outre, la formule
« il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit pas »
admet, elle aussi, plusieurs cas niant
chaque fois différemment
« il est nécessaire que le non-être ne soit pas ». Le
cas s’y opposant
frontalement est « il
est nécessaire que le non-être soit ». La formule de la
seconde voie « il n’est pas et il est nécessaire que le
non-être soit » est ainsi celle qui ne se contente pas de
nier mais qui s’oppose complètement
à la formule de la première
voie : elles
sont
orientées
exactement
en sens contraire.
Son choix n’est donc pas
fortuit – et Parménide fait ici la preuve d’une grande maîtrise
de la logique (y compris modale) des propositions ;
« il
est et il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit pas »
exprime, comme nous allons le voir, la troisième voie.
Le
non-être prenant la place de l’être en tant qu’origine et fin
de l’acte d’être, le monde auquel conduit la seconde voie est
doté des qualifications très exactement opposées à celles qui
caractérisent le monde de l’être vrai :
Toujours
au futur et au passé : rien n’est au présent, tout est
annonce et simultanément mémoire.
Multiple
et divisé : l’acte d’être connaît
tous les registres de l’altérité jusqu’à l’opposition à
soi-même.
Toujours
en mouvement et illimité : on retrouve là les
caractéristiques de l’air en tant que principe et fin de toutes
choses, au centre de la philosophie d’Anaximène.
Inachevé,
simultanément vert et pourrissant, naissant du pourri et périssant
à s’en alimenter,
tel un phénix héraclitéen cantonné à son état transitoire de
vermicule sorti de ses
propres cendres.
Si
Anaximène est visé, Héraclite l’est plus encore, notamment
lorsqu’il écrit : « La route, montante descendante, une
et même. » (fr. LX) Si le montant est le naissant et le
descendant le périssant, on est tenté d’en déduire qu’Héraclite
identifie le naissant au périssant, quand en fait il évoque un
cercle que l’on parcourt en montant d’un côté et en descendant
de l’autre, et affirme seulement que naître et périr
appartiennent au même cercle. Parménide s’attaque ici à un
Héraclite dont il a amputé la pensée de son concept central. Ce
dernier aurait cependant certainement assumé le fait que rien au
monde n’est au présent, que tout est annonce et mémoire.
La
seconde voie est pour Parménide une voie sans issue, une aporie, où
tout discours, errant de contradiction en contradiction, est toujours
faux et apparaît comme tel
au moment même où il est énoncé
(comme quand on dit :
« il est dix heures, six minutes, douze secondes » :
le temps de le dire, ce n’est
plus vrai).
Le
mutisme et
la surdité s’imposent.
Là
est la
nuit
de la pensée.
De fait le
non-être de la
seconde voie peut être
assimilé à la Nuit
hésiodienne,
mère spontanée de l’« acosmos » de la masculinité la
plus acharnée
à se détruire, celle
qui gouverne Ouranos lorsqu’il méconnaît le droit de Gaïa,
Cronos lorsqu’il méconnaît celui de Rhéa, celle que Zeus
parvient à éradiquer de l’Olympe et à transférer chez les
humains, dont les représentants les
plus parfaits sont les
hommes de la race de bronze.
La
seconde voie est celle qui admet le droit à l’existence de la
descendance masculine de Nuit. C’est
à ce titre que Parménide en dénie la praticabilité, car elle
justifie le « mauvais » masculin, celui contre lequel les
philosophes se sont toujours
élevés. En cela, il
continue de s’inscrire dans la ligne philosophique qui cherche à
distinguer l’homme de bien de l’homme vicieux.
(2-6)
Troisième voie
La
troisième voie est intermédiaire entre les deux précédentes. Sa
formule est « il est et il n’est pas nécessaire que le
non-être ne soit pas », ce qui recouvre plusieurs cas de non
nécessité pour le non-être de ne pas être. De fait, la troisième
voie est caractérisée par sa pluralité, et les mondes auxquels
elle conduit ne s’imposent jamais longtemps : preuve en est
l’école de Milet, avec trois cosmologies en trois générations de
philosophes. Parménide donne
rapidement une première option cosmologique (celle d’Héraclite),
puis développe plus amplement la sienne.
« […]
Ensuite écarte-toi / de l’autre voie : c’est
elle où errent les mortels / dépourvus de savoir et à la double
tête ; / en effet, dans leur cœur, l’hésitation pilote / un
esprit oscillant : ils se laissent porter, / sourds, aveugles et
sots, foule inepte, pour qui / être et non-être sont pris tantôt
pour le même / tantôt le non-même, et pour qui tout chemin /
retourne sur lui-même. » (fr. VI)
Cette
première version de la troisième voie est celle de l’incessant
va-et-vient de la première voie (où être et non-être sont pris
pour le non-même) à la seconde voie (où être et non-être sont
pris pour le même). Il ressort de ce va-et-vient une cosmologie
cyclique, le monde passant d’un état achevé, où l’être exclut
le non-être, à un état inachevé, où non-être et être se
mélangent, puis de nouveau à un état achevé, etc., en un cercle
qui ne se parcourt que par la destruction successive de ses relais.
Héraclite est clairement visé.
« Ils
ont, par convention, en effet assigné / à deux formes des noms ;
mais des deux cependant / une n’en est pas digne – et c’est
bien en cela / qu’ils se sont fourvoyés. Car ils ont estimé /
contraires leurs aspects, et leur ont assigné / des signes qui
fondaient leur distinction mutuelle. / Des deux, l’une est le feu
éthéré de la flamme, / c’est le feu caressant et c’est le feu
subtil, / identique à lui-même en toutes directions, / mais qui, à
l’autre forme, identique n’est pas ; / l’autre par son
essence à l’exact opposé, / c’est la nuit sans clarté, dense
et lourde d’aspect. / Voici tel qu’il nous semble en sa totalité,
/ le système du monde et son arrangement. » (fr. VIII)
La
seconde version de la troisième voie est marquée par l’indécision :
immobile entre les deux premières voies, celui qui l’emprunte
(Parménide parle à des hommes) se tourne simultanément vers l’une
et l’autre : il est l’homme à « double tête ».
Son immobilité l’empêche cependant de tourner en rond.
Regardant
du côté de la première voie, la première tête perçoit une
lumière radiante, une pleine clarté qu’aucun obstacle n’arrête,
une sphère lumineuse dont la source est une flamme, feu caressant et
feu subtil. On peut difficilement ne pas y reconnaître la Hestia
d’Héraclite dont la subtilité culinaire s’oppose à l’incendie
incontrôlable, mais aussi la Hestia de Xénophane accueillant son
hôte philosophique autour d’un feu caressant. Ce sont deux figures
nettement féminines que Parménide réunit pour en faire l’un des
deux principes du monde de la deuxième version de la troisième
voie.
Regardant
du côté de la seconde voie, la seconde tête ne perçoit rien. À
ce rien qui n’est qu’absence de lumière (selon Thalès, dont les
principes cosmologiques – terre centrale, lune, soleil les
éclairant, astres errants, étoiles fixes – sont repris par
Parménide), elle attribue cependant des qualités, densité et
opacité, et une source divine opposée à la lumière : Nuit,
déjà évoquée à propos de la seconde voie.
Jour
et Nuit se partagent le temps et l’espace (s’il fait nuit ici, il
fait jour de l’autre côté de la Terre sphérique ; s’il
fait nuit ici et maintenant, il fera jour ici dans 12 heures),
mais aussi la nature des choses.
« Puisque
toutes choses ont nom lumière et nuit, / et puisque telle ou telle
a, selon sa puissance, / reçu tel ou tel nom, toute chose est
remplie / à la fois de lumière et de nuit obscure, / l’une et
l’autre ayant part égale en sa nature, / puisque rien ne saurait
exister qui n’ait part / à l’une et à l’autre. »
(fr. IX)
Le
fragment VIII établissait que « lumière » et « nuit »
sont les deux noms qui s’imposent conjointement au monde. Or les
noms des choses leur sont donnés selon leur « puissance »,
ce par quoi elles sont remarquables et trouvent à s’exprimer dans
la pensée. Les caractéristiques liées à leur différence
spécifique d’avec les autres choses donnent lieu aux noms
communs. Les caractéristiques qu’elles partagent entre elles
donnent lieu à des noms transcendantaux, qui sont
justement ces deux qui s’imposent au monde.
« Les
plus étroits anneaux sont remplis d’un feu pur ; / ceux
qui viennent après,
de nuit ; dans l’intervalle / une portion de feu se trouve
répandue. Au milieu des anneaux est la Divinité / qui régit toutes
choses. Partout elle est principe, à la fois de naissance aux
cruelles douleurs / comme d’accouplement, projetant la femelle à
l’encontre du mâle afin de s’accoupler, / et de même, le mâle
auprès de la femelle. » (fr.
XII)
Il
convient d’éviter une lecture littérale de ce texte : en
Grèce, les descriptions du cosmos dépendaient des maquettes
réalisées par les philosophes de la nature pour le représenter. On
ne faisait pas de géométrie sans sa règle et son compas, pas
d’arithmétique sans son abaque, pas de cosmologie sans sa maquette
du cosmos. Par « anneaux » on doit dès lors sans doute
comprendre ceux qui,
dans une telle maquette, permettent de rendre compte des mouvements
des astres. Parménide semble
avoir voulu décrire ici
le Ciel indépendamment
de la Terre.
Le
Ciel est d’abord caractérisé par une série d’anneaux
successifs portant les astres et entourant la sphère de la Terre :
lune, soleil, planètes errantes, sources ponctuelles de lumière
pour les sphères que les anneaux décrivent. Il est ensuite
caractérisé par un fond noir, qui est pour Parménide une nouvelle
série d’anneaux, plus éloignés que les précédents, sources
uniformes de ténèbres pour les sphères qu’ils décrivent. Entre
les astres et le fond noir du Ciel, Parménide met en évidence la
Voie lactée, cette « portion de feu répandue »
au-dessus de laquelle règnent les ténèbres et au-dessous de
laquelle tournent les luminaires astraux.
C’est
dans la Voie lactée que loge la Divinité, principe de sexualité
reproductive. Il s’agit bien d’Aphrodite, qui se trouve être
la divinité suprême du monde de la seconde version de la troisième
voie, divinité non transcendante qui
règne sur le monde de façon immanente, composant
avec Hestia et Nuit,
qu’elle met au service de la reproduction des
êtres vivants faits de ténèbres et de lumière et ne s’y
résorbant qu’à condition de renaître. Il faut en effet
rapprocher la dualité parménidienne de la lumière et de la nuit,
de l’essence claire-obscure de ce qui naît pour mourir mais ne
meurt qu’avec la promesse d’une renaissance pour une nouvelle
mort, essence paradoxale qu’Hésiode a élevée au statut de
problème philosophique fondamental et qui a commandé toutes les
cosmologies philosophiques du – VIe siècle. L’Aphrodite
de Parménide tire les êtres vivants vers la lumière
et pousse
les deux sexes d’une même espèce l’un vers l’autre,
pour, avant
qu’ils ne retombent dans les ténèbres et ne
s’y dissolvent,
qu’en naissent
des successeurs.
« Avant
les autres dieux, elle conçut Éros. » (fr. XIII)
Pas
de confusion possible : la divinité suprême est bien
Aphrodite, et Éros, son parèdre mineur,
soumet les deux sexes à la loi de la reproduction.
« Quand
ensemble, homme et femme en même temps mélangent / les semences
d’amour, ou présents de Vénus, / la puissance versant dans la
veine un mélange / des deux sangs différents, doit savoir conserver
/ un parfait équilibre, afin que leur enfant / ait un corps bien
bâti. Si les puissances propres / aux semences mêlées se livrent
un combat, / renonçant à s’unir dans le corps de l’enfant, /
elles mettent à mal l’embryon assailli / par le conflit des
sexes. » (fr. 18)
Parménide
ne déroge pas à la doctrine de Pythagore en matière de
reproduction des corps, où les semences de l’homme et de la femme
concourent à égalité à la formation de l’enfant. On notera avec
intérêt le rapprochement entre le sang et la semence, qui, avec le
lait maternel, comme le rappelle Detienne, sont
la même substance vitale mais « cuite » de façon
différente. Parménide traite la chose de façon moins froide qu’on
aurait pu s’y attendre : la relation sexuelle sans amour
véritable, sans union des deux sexes, est préjudiciable à la
mixtion des semences et
in fine à l’enfant. C’est une façon originale de
condamner le viol, en inscrivant sa proscription dans la constitution
cosmologique – le droit naturel dirait-on aujourd’hui.
« À
droite les garçons, à gauche les filles. » (fr. XVII)
S’il
est admis dans les milieux pythagoriciens qu’un enfant hérite
autant de son géniteur que de sa génitrice et, à travers eux,
d’ancêtres qui mêlent leurs rameaux et qui les étendent à
l’échelle de l’espèce humaine, qu’il ne faut donc pas
s’attendre à se réincarner dans son enfant, l’identité
sexuelle de ce dernier reste un sujet de préoccupation. Qu’est-ce
qui peut bien orienter l’embryon vers l’un ou l’autre sexe ?
Est-ce dû à la suprématie biologique de l’un ou l’autre
parent ? Cela n’est guère probable : d’un même couple
ne sortent pas toujours des enfants d’un même sexe. Parménide, en
retenant l’égalité
absolue des semences et la relation amoureuse partagée qu’elle
implique, ne peut rendre compte de la différenciation des sexes que
par un facteur extrinsèque : la position dans la matrice.
Hommes et femmes ne se différencient donc en
aucun cas dans leur essence d’être humain !
La
seconde version de la troisième voie est, bien plus nettement que la
première version, marquée par le féminin. C’est bien
Aphrodite qui règne. La lumière et la nuit sont présentes dans la
constitution de toute chose : Hestia vers qui Aphrodite
s’attache à mener les êtres vivants, et Nuit qui attend
passivement d’absorber les corps sans vie qui rejoignent ses
ténèbres. La reproduction sociale est ainsi rapportée au féminin,
tout ce qui n’y a pas trait au
masculin, qui se déploie en effet dans la sphère
de la convention, parallèle à la sphère de la
nature : voilà pourquoi il n’en est pas question
dans un ouvrage intitulé Péri physèôn.
(2-7)
Libérer la masculinité
Parménide
s’inspire de la démarche de Xénophane sur deux aspects :
Xénophane
distingue une métaphysique propédeutique et une philosophie
pratique, de type utilitariste, à laquelle la première prépare.
Il semble bien que Parménide divise de même sa démarche
philosophique en deux étapes, mais à un niveau plus élevé, celui
de la métaphysique, qui se trouve divisée en une métaphysique
« pure », attachée à analyser et approfondir les
ultimes présupposés des constructions cosmologiques (selon
Parménide : la distinction entre l’être achevé et l’être
inachevé, la distinction entre l’être qui s’affirme de
soi-même et l’être qui se nie lui-même et nécessite un être
complémentaire pour être), et une métaphysique cosmologique
rendue consciente de ses présupposés, plus sûre de ses limites.
Xénophane,
en promouvant un monde à quatre principes, en identifiant le
masculin à la fluidité docile de l’eau opposée à la double
immobilité de la maternité sexuée de la terre et de la maternité
spontanée de l’air, maternité spontanée assimilée à
l’intelligence, construit simultanément le chemin d’une
émancipation masculine : la docilité masculine aux vues de
l’intelligence peut devenir instrument de la liberté des hommes
qui sauront s’approprier la maternité spontanée et la convertir
en intelligence pratique élevant l’activité masculine au statut
de pratique éclairée au service à la Cité. Il semble là encore
que Parménide suive le même dessein, mais à la différence de son
prédécesseur, il ne s’agit pas de dérober au féminin son
attribut le plus précieux, mais plutôt de mettre le masculin à
l’épreuve de sa dualité caractéristique, à la fois garant de
l’ordre du monde et destructeur continuel de cet ordre, à la fois
autoritaire
et injuste.
Que
la première et la seconde voies soient des exercices pour parvenir à
une formulation solide de la théorie du cosmos, cela est confirmé
par ce que j’ai indiqué au sujet des deux versions de la troisième
voie, toutes deux définies à partir des acquis des deux premières.
Pour autant, s’il ne s’agissait que d’exercices, il n’y
aurait pas de débat sur la cosmologie de Parménide : le monde
serait pour lui celui de la troisième voie et les deux précédentes
ne concluraient pas véritablement à des mondes, mais à des schémas
explicatifs concurrents pour le monde de la troisième voie. Il
s’avère cependant que le monde n’est pas pour Parménide un
concept premier, mais un concept second à déterminer par le biais
de concepts premiers. Le monde nous est inconnu a priori, et s’il y
a un monde dit « sensible », on ne peut guère en faire
la référence des théories cosmologiques, parce que la sensibilité
est intimement liée à la façon dont on est au monde : sans
tremblement, toujours méfiant, ou oscillant entre confiance et
tremblements. Ces trois manières d’être induisent naturellement
trois cosmologies parfaitement équivalentes. Tout l’enjeu est de
saisir leur lien et les conséquences de leur adoption quant à
l’être au monde.
Partant
du principe que la grande majorité oscille entre confiance et
tremblements à l’égard de toutes choses, que le monde de la
troisième voie s’impose donc à tous comme évident (Parménide ne
s’adresse qu’aux hommes, voire qu’à ceux qui se disent
philosophes), malgré la multiplication des théories qui le
décrivent et la difficulté qu’il y a à justifier l’une ou
l’autre, Parménide s’attache à montrer d’une part que dans un
tel monde, l’homme naturel ne tient une place que très marginale
et contrainte, d’autre part qu’il lui est possible de s’en
libérer par la discrimination de ce qui, dans sa nature, est positif
et négatif. Ayant renoué avec une masculinité positive, le
philosophe peut alors s’investir dans la vie de la
Cité, qu’il consolidera sans lui porter, de l’autre main, de
coup fatal.
Pour
Xénophane, le chemin de la libération masculine est celui de
l’intelligence ; pour Parménide, il est celui de la pensée
de l’être vrai, chemin féminin qui aboutit à un masculin certes
grotesque (la boule éternelle), mais chargé d’une indéniable
masculinité dans son opposition radicale à la maternité. La
masculinité se libère en reconduisant sa conflictualité à ses
conséquences dernières : son auto-destruction. L’être
vrai est le masculin qui subsiste après la destruction du masculin,
reste absolument affirmatif de son auto-négation : cela,
aucun philosophe antérieur n’avait imaginé que ce fût possible.
Mais à quel prix ? Un dieu masculin solitaire, sans autre
religion, sans autre lien avec les hommes que de leur servir de
modèle pour leur activisme politique.
(3)
Les paradoxes de Zénon :
vers une nouvelle sociabilité
masculine
On
riait beaucoup de l’être de Parménide à Élée. Son disciple
Zénon s’en est fait le défenseur par une méthode originale, mise
au point au cours de ses échanges avec les
moqueurs.
Il leur proposait de débattre d’une notion fondamentale rejetée
par Parménide (le multiple, le mouvement, le devenir) et
entreprenait de montrer qu’elle se contredit
elle-même, donc qu’elle n’a pas droit à existence ; si les
interlocuteurs admettaient les arguments de Zénon au fur et à
mesure de leur progression jusqu’à leurs conclusions, alors ils
devaient reconnaître que Parménide était moins éloigné qu’eux
de la vérité ; si les interlocuteurs parvenaient à réfuter
un argument à une étape de sa progression, alors Zénon était
obligé de reconnaître qu’il n’était pas capable de défendre
Parménide. Ainsi est née la dialectique, pratique masculine de
gestion des conflits typiquement pythagoricienne
(l’éthique
pythagoricienne bannissait
la colère des
relations d’amitié),
devenue rapidement, par la généralisation de ses thèmes,
le jeu préféré des élites intellectuelles grecques ainsi
qu’une pièce fondamentale du discours
philosophique.
La
règle du jeu impose une certaine technique du côté de celui qui
présente ses arguments : ils doivent rester le plus longtemps
possible anodins pour d’un coup aboutir à une conclusion qu’il
n’est plus possible de réfuter. D’où la relative sécheresse
des quatre fragments qui nous restent de Zénon. La dialectique
deviendra plus souple et se rapprochera de la rhétorique lorsqu’elle
multipliera les arguments et les enchaînera de façon subtile, ce
qui sera l’œuvre des sophistes.
Il
ne nous reste que trois fragments de démonstration au sujet du
multiple, et qu’un au
sujet du mouvement :
Zénon
semble avoir utilisé la preuve parménidienne par excellence, selon
laquelle l’être est commun à chacun des existants qui composent
le multiple, que donc ce qui les différencie n’« est »
pas, qu’ils ne « sont » pas multiples, que le multiple
n’existe pas. Les
fragments
qui nous restent, moyennant
quelques aménagements,
disent plus
précisément
ceci :
Une
chose existe « si
elle a une certaine grandeur, une certaine épaisseur »
(fr.
I) ;
faisant partie d’une multiplicité, ses limites ne sont pas
absolues mais relatives : ce sont des bornes marquant une
frontière qui ouvre sur d’autres choses existantes ;
partant ainsi
de
l’une
de ces choses existantes dans l’état de multiplicité et
rejoignant ses bornes, on
passe nécessairement à d’autres choses et de celles-ci à
d’autres
encore, et ceci indéfiniment.
Premier
point : soit la frontière entre les choses « est »,
soit elle n’« est » pas. Si elle n’« est »
pas, le multiple n’est pas non plus et il n’y a qu’un bloc
d’être, CQFD. Si elle « est », alors elle a une
certaine grandeur, une certaine épaisseur et des bornes, donc une
frontière ; et puisque la frontière est dans cette hypothèse
une chose existante, de nouveau cette frontière doit avoir une
frontière, et ainsi de suite à l’infini. Or, comme la frontière
de la frontière est plus petite que la frontière, la suite
indéfinie des frontières de frontières s’enfonce dans
l’infiniment petit jusqu’à atteindre une proximité
indiscernable avec ce qui n’a ni
grandeur ni épaisseur,
c’est-à-dire avec le non-existant.
Second
point : le monde est constitué soit
d’un
nombre donné de choses existantes, soit de choses existantes
innombrables. Si elles sont innombrables, quelle
que soit la limite que l’on se donne pour les
embrasser par la pensée,
un
nombre encore illimité de choses
se situeront en dehors de l’ensemble circonscrit
et
il faudra repousser la limite, et ainsi de suite à l’infini :
leur totalité n’est donc pas accessible et il n’est pas
possible de la qualifier dans
sa globalité, notamment de la qualifier de
« multiple ».
Si
au
contraire
elles sont nombrées, leur ensemble peut être légitimement
qualifié de « multiple », mais comme elles couvrent un
espace infini, certaines d’entre elles seront nécessairement
illimitées en grandeur et en épaisseur.
« Donc,
si les existants sont multiples, il est nécessaire qu’ils soient
à la fois petits et grands, petits au point de n’avoir pas de
grandeur, et grands au point d’être illimités. »
(fr.
I)
Cette
contradiction interne au multiple est problématique mais pas
destructrice. Il faut poursuivre encore le raisonnement, ce que
Zénon a dû faire dans deux directions.
D’une
part, en montrant que du côté de l’infiniment petit : (a)
la frontière avec le non-être n’est pas clairement établie,
(b) les existants sont innombrables et donc la qualification de
« multiple » tombe.
D’autre
part, en montrant que du côté de l’infiniment grand, même
si les choses existantes étaient en nombre limité, il ne serait
pas possible de connaître ce nombre, car la pensée, parvenue d’un
existant de taille finie à un existant de taille infinie, ne
pourrait jamais parcourir
ce
dernier dans
toutes ses bornes pour
passer aux existants suivants, ce
qui revient à
ne pas pouvoir les compter et
encore une fois à ne pas pouvoir apposer légitimement la
qualification de « multiple » à l’ensemble des
choses.
Cette
fois, Zénon est parvenu à détruire la notion de multiple, en
prouvant qu’elle promet plus que ce que la pensée est capable de
penser (de
compter).
À
propos du mouvement, Zénon a sans doute utilisé l’argument
d’Achille et de la tortue.
Celui
qui nous reste concerne la flèche qui n’atteint jamais son but.
« Ce
qui se meut ne se meut ni dans le lieu où il se trouve, ni dans le
lieu où il ne se trouve pas. »
(fr. IV)
Dans
le monde de la seconde voie, le mouvement peut s’expliquer
facilement : une chose ayant
toujours déjà quitté son lieu en même temps qu’elle ne l’a
jamais encore rejoint, c’est son
degré de dispersion autour de son lieu qui qualifie son mouvement,
rapide si la dispersion est grande, lent si elle est réduite. Par
contre, dans le monde de la première voie qui
ne sort jamais du présent,
en
rendre
compte est
impossible. Zénon cherche à montrer que l’on raisonne toujours
selon les principes de la première voie, notamment
au présent,
que l’on
ne peut donc, par le raisonnement, parler de l’inachèvement ou de
l’instabilité des choses.
(4)
Conclusion
Parménide
a-t-il été masculiniste ? Il n’est pas le premier philosophe
à avoir pensé le monde au masculin, mais tous ceux qui l’ont fait
avant lui le suspendaient à un principe supérieur, transcendant ou
immanent, au féminin. On ne peut pas dire que Parménide déroge à
la règle, mais il parvient, dans sa première voie, à construire
un monde masculin dont le principe féminin supérieur s’efface dès
l’avoir suscité
sur un plan radicalement transcendant (au-delà de
l’être et du non-être, par une décision
en faveur de l’être plutôt que du
non-être, une décision féminine pour la maternité plutôt
que pour la virginité) : un monde masculin toujours déjà
émancipé du féminin.
Que
faire de ce monde masculin si peu conforme à ce que l’être humain
perçoit de ce qui l’entoure ?
Il
est le seul monde pensable sans contradiction, mais il n’est que
l’un des trois mondes possibles.
Chacun
de ces mondes est lié à un état d’esprit (sérénité,
tremblements, oscillation), à un être au monde de la pensée (âge
d’or de la constance, âge de bronze de l’autodestruction, âge
de fer de la réforme régulière et de la révolution permanente),
autant qu’à une relation entre féminin et masculin (masculin
émancipé par le féminin, masculin avorté du féminin, féminin
dominant le masculin).
La
façon de concevoir le troisième monde renseigne sur la masculinité
promue (ou vécue) par celui qui le conçoit. En choisissant le
point de départ le moins féminin, il promeut en réalité le
masculin ensauvagé né de Nuit, mère séparée avant terme de sa
progéniture. En choisissant le point de départ le plus féminin,
il promeut au contraire le masculin émancipé et mesuré né d’une
Gaïa qui a opté pour la maternité contre la virginité et qui a
si bien réussi son ouvrage qu’elle peut se retirer complètement.
La
cosmologie de Parménide formalise la trajectoire émancipatrice du
masculin et prépare l’homme à son rôle politique. C’est aussi
le but du pythagorisme, mais pour Pythagore l’émancipation des
hommes et des femmes passe
autant par la discipline que par l’alimentation. La purification
parménidienne est masculine et se concentre sur une forme de
discipline conjointement intellectuelle et affective.
On
est bien en présence d’un masculinisme philosophique, mais dont le
sens dépend encore du féminin. Parménide
et Zénon font
nettement la distinction entre le féminin tout court qui ne les
intéresse guère et le féminin du masculin, qu’ils revendiquent
pour eux.
D’où le soupçon d’homosexualité, dont on ne peut dire s’il
est fondé ou non, mais qui résonne avec leur tentative de
construire un modèle d’amitié masculine complètement émancipé
des femmes, en continuité avec les préoccupations de Xénophane.